Notre Première Mondialisation : Leçons d’un échec oublié
Ouvrage de Suzanne Berger
jeudi 23 février 2017 Etudiants Prépa HEC1
Notre Première Mondialisation - Leçons d’un échec oublié. Suzanne Berger. Seuil, Paris 2003. Résumé d’ouvrage par Lucie GUIGNET
Suzanne Berger, née en 1939, est une historienne et politologue américaine, spécialiste de la France et de la mondialisation. Elle travaille actuellement au M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) à Cambridge University en tant que professeur de sciences politiques. Bibliographie : Notre Première Mondialisation : Leçons d’un échec oublié (2003) ; Made in monde (2008)
Problématique
Pour Suzanne Berger, la mondialisation ne signifie pas « un marché mondial unique ». Ce serait davantage le constat que « les échanges internationaux ont pris une telle importance dans nos économies que les marchés extérieurs y déterminent de plus en plus les prix, c’est à dire la distribution des ressources et des revenus ». Ainsi, dans quelle mesure État, démocratie et mondialisation peuvent-ils s’accorder ? Quels enjeux cela soulève-t-il ?
Résumé
1. Une première dimension de la mondialisation étudiée et problématisée par Suzanne Berger est sa dimension économique et financière. Au préalable, l’auteure précise les mutations et les révolutions qui constituent les fondements de l’internationalisation. Elle distingue deux types d’innovations centrales : les innovations techniques, qui ont donné les moyens techniques aux flux internationaux, et les innovations institutionnelles qui en ont fixé les bases légales.
Les innovations techniques correspondent à une période d’innovations technologiques, permettant d’abaisser les coûts de transports et de communication. Suzanne Berger évoque par exemple, l’installation du câble transatlantique, dès 1860 en ce qui concerne la première mondialisation, ainsi que les performances d’Internet et de la Toile actuelles. Quant aux innovations institutionnelles et politiques, on constate que, outre les révolutions dans domaines transports et communications, le rôle des choix politiques dans l’établissement de la mondialisation est tout aussi fondamental. Ainsi, les accords commerciaux (accords de libre échange, traités commerciaux et tarifs douaniers) ont joué un rôle significatif dans l’avènement de la mondialisation. Lors de la première mondialisation les accords étaient majoritairement bilatéraux (accord franco-britannique de 1860). On constate que de nos jours, malgré un encouragement au multilatéralisme de l’OMC, le bilatéralisme s’affirme toujours (ex : ALENA, UE..).
Le système monétaire fait aussi l’objet d’innovation institutionnelle : un système de changes fixes réduit le risque de fluctuations des cours et crée les conditions de développement des échanges (par exemple, le système d’étalon-or). Depuis 1976, avec les accords de Jamaïque qui mirent fin au système de Bretton- Woods, le système monétaire international est un système flottant (les devises des monnaies s’établissent selon la loi de l’offre et de la demande sur le marché des changes). Enfin, les marchés financiers et leur régulation sont déterminants. Lors de la première mondialisation, la législation favorisait la création de sociétés et de banques par actions ainsi que la création d’un marché financier ouvert au grand public. Suzanne cite Léon SAY, ministre des finances sous la IIIème République, qui se réjouissait du format papier des actions, facilement transportables et rendant donc les échanges très fluides. Depuis les années 1990, les technologies de l’information ont permis la « dématérialisation » des titres, un 4ème « D » venant s’ajouter à la théorie de Henri BOURGUINAT.
Ensuite, Suzanne Berger évoque le cas de l’internationalisation des capitaux, au coeur du système actuel. Si un marché mondial des capitaux existait avant 1870, il était largement dominé par quelques grandes banques et familles (les Rothschild, les Hope, les Baring). Avec la première mondialisation, le marché s’ouvre à de nouveaux acteurs. On voit donc, grâce à la nouvelle structure des marchés financiers internationaux, l’essor de petits épargnants qui investissent à l’étranger. Suzanne Berger souligne que les investissement directs d’avant guerre s’approchent des proportions actuelles. Toutefois, ils étaient alors largement dirigés vers les compagnies de chemins de fer, et récemment, ils s’orientent vers la « nouvelle économie », à savoir les NTIC. Dans le cas plus spécifique de la France, les investissements se dirigeaient peu vers son empire (contrairement à la Grande-Bretagne) et près d’un quart allaient en Russie.
Suzanne Berger souligne le caractère irrationnel de ces investissements directs à l’étranger, et ajoute que cela est propre aux investisseurs de la première comme de la seconde mondialisation : les comportements mimétiques, « qu’il s’agisse des tulipes [référence crise des tulipes de 1637] ou de la nouvelle économie », amènent à la constitution de bulles spéculatives. La spéculation était déjà d’actualité et les épargnants pariaient sur le développement de l’industrie russe. Il faut dire aussi que la France faisait partie des pays les plus développés et que sa croissance était donc moins rapide. Tout comme aujourd’hui, avec plus de la moitié des IDE mondiaux dirigés vers les BRICS, les épargnants investissent dans les pays ayant le plus grand potentiel de développement (calcul du taux de rendement des investissements). On comprend seulement à la fin du XIXème siècle pourquoi la Russie constituait un mauvais pari, puisque celle-ci compte toujours parmi les pays en développement. Cela pousse à l’interrogation : les territoires de l’empire étant déjà « acquis » politiquement, les investissements massifs en Russie, Amérique Latine et Proche-Orient ne relèveraient-ils pas de l’impérialisme ?
Enfin, Suzanne Berger en vient à la place nouvelle des banques dans ce système financier mondialisé. Nous avons déjà abordé le fait que la mondialisation des marchés financiers coïncida avec l’arrivée des petits épargnants sur le marché. Cette nouvelle caractéristique amena à une nouvelle place des banques dans ce système mondialisé, un rôle d’intermédiaire. Les banques de dépôts (le Crédit Lyonnais par exemple) dirigeaient l’épargne individuelle vers les investissements, les épargnants choisissant entre quelques options institutionnelles, et il apparait que lors de la première mondialisation, celles-ci favorisaient l’étranger (en particulier la Russie). Selon les économistes libéraux de l’époque, les investissements en France avaient un rendement trop faible du fait d’une croissance molle, de la stagnation démographique ou encore de taux d’épargne élevés. Or, ces éléments qui justifiaient ce faible taux d’investissement, ne permettaient pas la reprise et inscrivaient la France dans le cercle vicieux de la stagnation économique. En somme, ce manque de confiance dans les placements français bloquait économie, un problème toujours d’actualité. Ainsi, déjà lors de la première mondialisation, les banques étaient les clés de voute du capitalisme moderne et Lénine en développa une analyse du pouvoir financier dans le capitalisme moderne.
2. Dans un second temps, l’auteure analyse les dimensions sociale et politique, indissociables, qui touchent davantage la population et constituent dès lors le véritable trilemme de la mondialisation. L’impact des flux internationaux sur la société était autant un sujet de débat lors de la première mondialisation que de nos jours.
La question de la démocratie apparait alors comme centrale et représente un enjeu majeur. La démocratie peut-elle subsister dans un monde sans frontières ? De nos jours, nous craignons que la mondialisation n’avantage le capital dans la tension
fondamentale entre démocratie et capitalisme, c’est à dire entre une distribution du pouvoir déterminée par le suffrage et une autre dépendant des relations sociales liées à la production et à la propriété. Il est vrai que l’on peut se demander quelle est l’influence réel d’une FTN, dont le chiffre d’affaire dépasse le PIB de certains pays.
L’Europe constituait-elle une réponse à la mondialisation, dans le mesure où l’union serait « la bonne échelle » d’action ? Suzanne Berger reste très critique : plutôt qu’une réponse, l’Europe est l’un des vecteurs les plus puissants de la mondialisation et son initiative politique est inexistante. Certains parlent même de « déficit démocratique » à son égard. On ne peut que douter que Europe soit capable de relever les défis démocratiques et sociaux de la mondialisation, du moins tant qu’elle n’adoptera pas un projet politique et ne réorientera pas son action sur un de ces objectifs initiaux, à savoir le bien-être social.
Néanmoins, plus que la démocratie, ce sont aussi les conditions sociales que redoutent les travailleurs. Il est intéressant de rappeler avant toute chose que ce fut au cours de la première mondialisation, que la Chambre des députés adopta la semaine de 6 jours, la journée de 10 heures, ou encore les retraites.
Nous savons que sur le long terme, la libéralisation des échanges amène à une convergence des prix des facteurs, comme le souligne la définition même que donne Suzanne Berger de la mondialisation ou comme l’établit le théorème HOS. Cela explique pourquoi aujourd’hui, dans les pays développés, où le capital est relativement important, les capitalistes soutiennent la libéralisation des échanges (commerciaux et financiers) alors que les travailleurs s’y opposeront. La menace pour l’emploi et la distribution des revenus vient des travailleurs chinois, indiens, russes et turcs, qui bénéficient d’un bon niveau d’études et jouissent d’une environnement national favorable aux investissements étrangers.
Toutefois, la première mondialisation nous donne ici une leçon fondamentale : la mondialisation n’empêche pas l’adoption de lois fiscales aux effets redistributifs importants. Par ailleurs, c’est à cette époque que les premières fondations de ce qu’on appellera plus tard l’État-providence, furent mises en place et la législation sociale se développa en France. Déjà à ce moment-là, lors de l’adoption de ces mesures, la question de la compétitivité fut posée mais les lois passèrent tout de même. La première mondialisation a tiré la société vers le haut et non vers le bas.
Enfin, un interrogation que soulève ce trilemme, est le rapport entre paix et système économique globalisé, qui voit se multiplier les théories, auxquelles l’histoire saura donner raison ou non. Quels effets sur la guerre et la paix auront l’intégration et l’ouverture internationale ? Nous avons dès lors d’un côté les partisans d’une réduction des risques de guerre, à savoir par exemple Jean Jaurès en France ou Norman Angell en Angleterre. À l’opposé, Lénine soutient la thèse du conflit. Selon lui, les échanges mondiaux provoqueraient des différends entre les capitalistes des différents pays, favorisant le risque guerre.
À l’époque de la première mondialisation, le grand débat portait surtout sur les relations franco-allemandes. Mais au-delà, la véritable question était de déterminer si l’interdépendance économique rendrait les États moins susceptibles de se faire la guerre. L’ouvrage The Great Illusion (1910) de Norman Angell émettait l’idée que la guerre serait irrationnelle dans la mesure où elle couterait trop cher aux réseaux des échanges économiques internationaux. Pour Jaurès, le seul danger venait de l’internationalisation capitaliste des échanges conjugué à la recherche de puissance et d’impérialisme des États dans la colonisation. Sinon, la mondialisation pouvait jouer en faveur de la paix, notamment conjuguée à une pression démocratique. Finalement, la Grande Guerre fut totale et détruisit presque tous les liens d’interdépendance économique.
La leçon a tirer de l’histoire est donc que les liens internationaux d’un système économique mondial ne génèrent pas forcement ordre et sécurité, que l’ordre mondial économique n’est pas fondé sur le pacifisme politique.
3. Finalement, l’ouvrage Notre première mondialisation est porteur d’un message fondamental : la nécessité de revoir notre système de gouvernance. L’expression « Penser global, agir local » est au coeur de ce projet. Tout d’abord, Suzanne Berger part du constat de l’évolution des partis de gauche, qui témoigne d’une approche moins sévère du capitalisme et de la mondialisation.
À la fin du XIXème siècle, la gauche était anticapitaliste mais acceptait la mondialisation. Aujourd’hui, la gauche accepte le capitalisme et le système de marché, mais lutte contre la mondialisation ou, plus précisément, défend des structures économiques et sociales menacées. Ce changement de politique de la gauche vient de l’évolution dans la perception des intérêts de ses électeurs. Lors de la première mondialisation, la gauche voyait ses électeurs principalement comme des consommateurs et considérait donc que le protectionnisme lésait leurs intérêts en terme de pouvoir d’achat. Au contraire, aujourd’hui, la gauche voit ses électeurs comme des producteurs, dont les intérêts seraient alors le revenu et l’emploi, menacés par la mondialisation.
Autre différence avec la période de 1870-1914, la gauche ne différenciait pas les intérêts des travailleurs locaux et étrangers, ce qui explique leur raisonnement en terme de consommation. De nos jours, si l’objectif politique, de la gauche ou d’une autre tendance politique, était d’encourager la hausse des salaires et des conditions de travail dans les pays concurrents tels que la Chine, il faudrait que les pressions extérieures soient relayées au niveau local, pour permettre aux travailleurs de s’organiser et de s’unir. Par ailleurs, il faudrait parallèlement que les pays développés acceptent d’ouvrir réellement leurs frontières à une nouvelle vague de biens et services. Le programme du PS français, qui accepte la nécessité de la mondialisation (à contre coeur), s’oriente vers l’objectif de réguler au maximum les échanges, pour distribuer plus équitablement au niveau local les coûts sociaux de la mondialisation. En somme, on voit ici à l’échelle d’une famille politique, la persistance de la politique dans le domaine économique, que cela soit au travers de l’idéologie que des intérêts électoraux.
Ensuite, l’auteur souligne le rôle de l’État, qui persiste indéniablement dans ce système mondialisé, malgré les incertitudes. Avant l’heure de la mondialisation, la politique de l’État consistait à empêcher ses ressources stratégiques de quitter le territoire (même dans la Venise de la Renaissance, les souffleurs de verre étaient menacés de prison s’ils exportaient leur production). Ce temps étant révolu, la régulation des exportations de capitaux s’appuie sur des instruments institutionnels. Le cas des investissements russes, à la fin du XIXème et jusqu’au début du XXème siècle, est ici éloquent, et l’exportation de capitaux servait des intérêts purement politiques. En effet, le ministre des Affaires étrangères considérait les investissements en Russie comme le moyen de casser l’alliance avec l’Allemagne. Mais l’état des finances russes et l’instabilité du régime tsariste (révélé en 1904-1906) aurait dû découragé les investisseurs. D’une manière qui pourrait sembler paradoxale, l’État empêcha alors les investisseurs à avoir accès aux informations, en interdisant que certaines valeurs étrangères soient cotées à la Bourse de Paris. Par ailleurs, l’État orienta sa politique fiscale de manière à ce que les impôts sur les investissements étrangers soient moindres. De manière informelle, l’État corrompit les journalistes pour que ces derniers donnent une bonne image des finances russes.
Dès lors, cette présence de l’État dans la mondialisation qui en fait un acteur-clé, explique la fragilité et la réversibilité de la mondialisation, qui dépendent avant tout des politiques publiques. Nous avons vu que l’État était, autant que le progrès technique, à la base de la mondialisation, et c’est cela même qui explique sa fragilité. En effet, l’auteur parle d’une mondialisation « en dents de scie », or les innovations et le progrès, eux, ne reviennent pas en arrière. Si la mondialisation n’est pas irréversible et infaillible, c’est parce que « la mondialisation tient autant aux politiques publiques de libéralisation et de dérégulation qu’aux avancées technologiques ».
Ce « retour en arrière » peut être la conséquence de différentes causes. L’impératif de sécurité nationale (par exemple, lors des attentats du 11 septembre 2001), fait se fermer les frontières d’un pays, répondant ainsi à l’idée que les menaces mettent plus facilement en danger la nation lorsque les frontières sont ouvertes. Le facteur de l’inquiétude public est aussi décisif, et peut être lié à cette première cause évoquée précédemment, ou alors être d’ordre économique ou sociale. La troisième cause que l’on note sont les relations entre les pays, qui peuvent être « froides ». En 2014, la Russie met en place un embargo sur les produits agroalimentaires européens, représailles russes de premières représailles économiques européennes, sur fond de crise ukrainienne. Suzanne Berger souligne qu’aujourd’hui, comme lors de la première mondialisation, « nous sommes aussi susceptibles d’accepter une limitation significative du mouvement international des biens, des capitaux et du travail si nous nous sentons menacés par des dangers qui traversent nos frontières ». Inutile de rappeler les innombrables exemples tirés de l’actualité, comme l’accueil de réfugiés, limité et difficile alors que la menace terroriste inquiète le peuple et les politiques. Les marges d’initiatives de l’État n’ont pas disparu et le rôle des frontières persistent dans la régulation des flux. Il y a un ancrage national indéniable : la plupart des FTN concentrent leur activités à forte valeur ajoutée (conception, R&D, design, marketing…) dans leur pays d’origine.
Enfin, Suzanne Berger en vient au point crucial : une politique nationale dans un contexte international est-il possible ? Aujourd’hui, la gouvernance internationale se fait en grande majorité par les normes, compromis entre l’ouverture économique des frontières et la persistance d’un semblant de souveraineté nationale. C’est l’objectif d’organisations telles que l’OMC ou le FMI, notamment pour la lutte contre le dumping, mais cela nécessite un système de contrôle et de législation efficace. Or, on voit aujourd’hui la défaillance d’une institution internationale telle que l’OMC, et donc la nécessité d’étudier des alternatives.
Il y a depuis toujours une croyance que la gouvernance ne peut se réaliser qu’à l’abri des frontières. Suzanne Berger avance l’idée que nous pourrions abandonner l’espace de contrôle démocratique qui est celui des frontières nationales, et par là approfondir le processus de mondialisation. Dani RODRIK se place du même côté, en affirmant qu’un gouvernement mondial serait la seule forme de gouvernance à conjuguer intégration économique internationale et démocratie. Mais si nous ne pouvons rien affirmer sur le long terme, il apparait qu’une telle révolution soit impossible sur le court terme, du fait notamment de la persistance d’une souveraineté nationale dans les États. Ainsi, la solution pourrait être de jouer à deux échelles : à l’échelle mondiale, veiller à établir des institutions et des normes plus démocratiques ; tandis qu’à l’échelle nationale, Suzanne Berger souligne la nécessité de renouveler nos pratiques et réformer nos institutions, c’est à dire s’attaquer à la structure même de notre pays, afin de les adapter à l’organisation actuelle du monde.
Du point de vue géopolitique, l’expérience des guerres mondiales et notamment de la première qui mit fin à la première mondialisation, nous montre qu’il ne suffit pas de prendre les acteurs politiques nationaux dans une toile d’interdépendance économique. La paix nécessite la création d’un ordre international (Société des Nations Unies, l’ONU). Mais dans chacun des cas, ces institutions dépendirent de la volonté des puissances dominantes. Les théories des relations internationales appuient ce point : les périodes d’ouverture et de paix internationales correspondent souvent à la domination hégémonique d’une seul pays (Grande Bretagne au milieu du XIXème, Etats-Unis)
Synthèse
Le principal problème que pose la mondialisation, aujourd’hui comme hier, est politique. Son défi démocratique vient des inégalités toujours croissantes de revenu et de pouvoir que notre système économique engendre. L’ONG Oxfam a récemment publié un rapport indiquant que les 8 plus grandes fortunes mondiales détenaient la moitié des richesses. L’enjeu est donc de pouvoir faire coïncider une volonté politique et un accord social global, dans l’objectif de favoriser la redistribution des richesses, pour que les coûts de la mondialisation, qui se concentrent et font s’affirmer le populisme, soient compensés. L’originalité de l’ouvrage de Suzanne Berger réside dans ce parallèle qu’elle établie entre ce qu’elle appelle la « première mondialisation » et la mondialisation que nous connaissons aujourd’hui. Plus qu’un parallèle, elle démontre une véritable convergence et donc la possibilité de tirer des leçons de la période 1870-1914
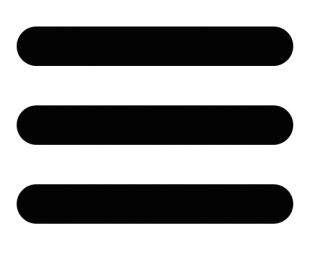

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
 LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER
LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER