HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
LA RÉSILIENCE : UN RÉCIT PROGRESSISTE DE SUBSTITUTION FACE AUX MULTIPLES CHOCS DE LA POSTMODERNITÉ. Baptiste RAPPIN
Chocs politiques, sociaux, économiques, psychologiques...
mercredi 18 octobre 2023 Baptiste RAPPIN
Rappelez-vous... lorsque « la compétition n’était qu’économique... ». L’individu devait être efficace et surtout résilient, un paradigme bien connu basé sur la responsabilité individuelle, chère au néo-libéralisme. Mais depuis les derniers grands chocs (Covid19, guerre en Ukraine et au Moyen-Orient), la notion de résilience se déplace aussi vers le collectif. Sans compter que les inégalités affectent profondèment la résilience collective. On tente désormais de relier - bien-être - résilience - soutenabilité [1]. On construit des indices de résilience nationale.
A l’évidence, le problème environnemental relève fortement de cette approche, car les humains bouleversent les grands cycles biogéochimiques du système-Terre. Le concept s’inscrit dans l’air du temps. Dans ce texte riche aux champs multiples, Baptiste Rappin (1) vous dit tout sur ce mot (peut-être un concept). Un récit pour dépasser la conception tragique du destin et de l’Histoire... ? Et en perspective, une interrogation sur la démocratie de demain. P.L
(1) L’auteur est Maître de Conférences HDR à l’IAE Metz School of Management (Université de Lorraine) où il dirige le Master de Ressources Humaines. Cet article inédit est tiré d’un colloque en novembre 2019 à l’IAE Metz School of Management (thème « Management et résilience »). Une notion qui dépasse de loin la seule question du management, une glorification d’un vocabulaire qui questionne... On ne saurait vivre en dehors de son contexte. Dernière publication : Anachronismes. Éléments pour une philosophie de l’intempestivité. Editions Ovadia, 30 novembre 2023

INTRODUCTION : les multiples visages de la résilience
Commençons notre propos en enfonçant une porte déjà grand ouverte : la notion de « résilience » est à la mode, elle rencontre actuellement un succès considérable, que ce soit dans les revues scientifiques de sciences humaines ou dans les publications de vulgarisation, que ces dernières concernent le développement personnel ou le management. Pour ce qui est du cas français, sa célébrité est principalement due aux ouvrages grand public de Boris Cyrulnik parus autour des années 2000, tout d’abord Un merveilleux malheur en 1999, puis Les vilains petits canards en 2001 : des titres marquants, un oxymore puis une expression populaire, ainsi qu’un style abordable et quasi-romancé ont continué à rendre accessible ce concept scientifique, à l’histoire aussi longue que la révolution industrielle, auprès des non-spécialistes.
Mais la célébrité de la résilience ne tient pas de la seule notoriété du psychiatre toulonnais ; si ce dernier rencontre une certaine audience, c’est bien parce que son propos s’inscrit dans l’air du temps et qu’il se fait la caisse de résonance des angoisses et des attentes des sociétés postindustrielles. La résilience, en effet, offre la promesse de la réussite et du bonheur en dépit des coups du sort, malgré les obstacles, nonobstant les accidents : elle renouvelle la fiction du progressisme qui, disparu sous les décombres de la Seconde Guerre mondiale, fait peau neuve en infiltrant un niveau cette fois-ci infra-social et infra-politique, celui du psychisme qui abrite la scène d’une véritable dramaturgie comprenant les moments de la catastrophe – le traumatisme – et de l’heureux dénouement – le rebond du héros. Au fond, par les gros temps de néolibéralisme que nous vivons et qui rendent la situation de la plupart d’entre nous précaire, il est de fait rassurant de croire en la possibilité de notre épanouissement quoique les éléments, non pas naturels, mais politiques, sociaux et économiques, semblent se liguer contre nous. Peut-être faut-il même y voir, comme y invite Thierry Ribault (2021, p. 61), « une formule magique de substitution ».
La prospérité que connaît la notion de résilience s’observe toutefois à d’autres indices que ceux strictement commerciaux liés à la bonne vente des ouvrages sur les étals des libraires. En effet, le succès d’un concept s’aperçoit également lorsqu’il s’impose dans l’imaginaire de l’époque et que, par voie de conséquence, il en vient à sortir des frontières de sa discipline d’origine et se voit transféré dans des champs qui lui étaient initialement étrangers. La résilience, née au XIXe siècle dans les eaux de la physique des matériaux puis de la biologie pulmonaire, s’est progressivement imposée en psychologie, puis dans plusieurs sciences humaines : les sciences de l’éducation, la sociologie, les sciences de l’organisation, l’écologie. C’est la raison pour laquelle le lecteur peut éprouver quelque surprise à découvrir autant d’adjectifs accolés à ce nom : « organisationnelle », « familiale », « écologique », « psychologique », « individuelle », « systémique », « économique », et à le voir associer à une pluralité d’autres expressions : « protection de l’enfance », « prévention des désastres », « développement », « soutenabilité », « dépendances », « vulnérabilité », « traumatisme », « gestion des risques », etc. C’est dire que les chercheurs étudient la résilience sous toutes ces coutures : dotée des mêmes propriétés d’élasticité que les systèmes qu’elle étudie, elle s’appliquerait aussi bien à la nature qu’au vivant et à l’être humain dans ses multiples niveaux d’organisation (psychisme, famille, entreprise, nation, etc.).
De telle sorte que l’esprit sinon scientifique du moins rationnel et sceptique éprouve, au fur et à mesure des lectures, beaucoup de doutes et en vient à se poser de multiples questions qui demeurent dans un premier temps sans réponses. Un concept aussi unifiant que celui de « résilience » est-il encore un concept ? Relève-t-il encore de la science ? D’où provient ce pouvoir englobant ? Et quelle fonction anthropologique joue-t-il ? Et que nous révèle-t-il du management et des sciences de l’organisation ? C’est à cet ensemble d’interrogations que le présent article aimerait s’attaquer afin d’offrir les linéaments d’une saisie plus globale du concept de « résilience ».
1. Aux origines de la résilience et de son succès
Comprendre la résilience, la rendre intelligible, c’est d’abord, avant même de se pencher sur sa définition et sur sa généalogie puis d’entamer le travail d’interprétation conceptuelle, l’insérer dans le contexte général dans lequel elle prend son essor. Son succès nous paraît en effet lié à la structure anthropologique de notre époque, que nous placerions volontiers sous le label général de « crise » ou encore de « société critique », pour signifier que l’alternance entre normalité et crise, incarnée de façon exemplaire par le jeu binaire de la santé et de la maladie, s’estompe au profit d’une urgence de tous les moments.
Évidemment, nombre de philosophes et de sociologues se sont déjà penchés sur la question, et nous ne prétendons point innover en la matière. Rappelons les éléments d’analyse essentiels, saillants et pertinents à la saisie de notre objet : la résilience.
Prenons comme point de départ le regard que pose Jean-François Lyotard sur notre époque dans La condition postmoderne. Il y décèle la fin des grands récits qui structuraient la modernité (le récit national, le récit communiste, etc.) et inventorie les murs porteurs de l’ancien monde qui s’effondrent sans qu’aucune nouvelle architecture ne leur succède : « La nouveauté est que dans ce contexte les anciens pôles d’attraction formés par les États-nations, les partis, les professions, les institutions et les traditions historiques perdent de leur attrait. Et ils ne semblent pas devoir être remplacés, du moins à l’échelle qui est la leur » (Lyotard, 1979, p. 30). La postmodernité se caractérise au fond plus par ce qui la précède, la modernité sur laquelle elle calque son nom, que par elle-même. À l’homme sans qualités de Musil succède en quelque sorte l’époque sans qualités.
Ne reste plus alors que le changement permanent. De son côté, Zygmunt Bauman (2006, p. 7) nomme « liquide » cette société « où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer en habitudes et en routines ». Quand tout circule, quand tout s’écoule et que ne subsiste que le seul flux, alors tous les repères stables et tous les points fixes sont voués à se fondre dans la circulation généralisée. Emportés par le mouvement permanent, les hommes ne trouvent plus le secours d’une structure, d’une institution ou d’une routine : toutes ces formes de vie sociale solide, qui tiennent donc de l’archaïsme, constituent autant de freins et d’obstacles à l’adaptation à la nouvelle donne de la fluidité.
Mais non seulement les anciennes bornes, les anciens périmètres, les anciennes références s’évanouissent-ils, mais en outre le temps, ou plutôt notre rapport au temps, se trouve-t-il caractérisé par le phénomène d’accélération remarquablement mis en exergue par le théoricien critique Harmut Rosa. Ce dernier identifie plus particulièrement trois formes d’accélération qui cumulent leurs effets : tout d’abord, l’accélération technique qui trouve son origine dans l’essor des technologiques de la communication, des premiers trains jusqu’aux réseaux sociaux contemporains ; ensuite, l’accélération du rythme de vie qui se mesure au nombre grandissant d’événements vécus par unité de temps ; enfin, l’accélération de la vitesse des transformations sociales et culturelles qui renvoie à la perpétuelle volonté de modernisation des sociétés. Au fond, le remplacement immédiat d’un ancien nouveau par un nouveau nouveau rend impossible la pétrification de l’innovation et contribue à alimenter l’éternel cycle de la société liquide.
Néanmoins, Harmut Rosa (2010, p. 12) n’en reste pas à ce constat : pour lui, la crise du temps mène à la perception répandue et partagée d’un « temps de crise ». En effet, l’innovation, rendue possible par le développement fulgurant de la société industrielle et postindustrielle, mène à la création de risques, de menaces, dont les effets parfois irréversibles, en raison de la nature systémique de la science contemporaine, ne se dévoilent qu’après coup. Ce constat est commun à Hans Jonas à son éthique de la responsabilité intergénérationnelle, à Jean-Pierre Dupuy et à sa thèse du catastrophisme éclairé, ainsi qu’à Ulrich Beck dans son analyse de La société du risque. D’ailleurs, dans cet ouvrage, le sociologue (2001, p. 43) ne manque pas de remarquer que « la société du risque est une société de la catastrophe » et que « l’état d’exception menace d’y devenir un état normal ».
Il n’y a qu’à songer à l’écho que rencontre la collapsologie depuis une décennie pour constater à quel point la thèse d’Ulrich Beck s’avère pertinente. Pour les auteurs qui s’inscrivent dans ce courant de pensée, toutes les conditions semblent réunies pour que nous assistions prochainement à un effondrement de la civilisation capitaliste, donc mondiale ; en effet, comme le soulignent Pablo Servigne et Raphaël Stevens (2015, p. 17), « depuis quelques décennies, les humains sont devenus capables de bouleverser les grands cycles biogéochimiques du système-Terre, créant ainsi une nouvelle époque de changements profonds et imprévisibles ». Non seulement le temps s’accélère-t-il, mais en outre nous conduit-il tout droit vers la fin du monde que nous connaissons ; et, qui plus est, le dénouement se rapproche puisque nous y allons de plus en plus vite.
Que ressort-il des propos précédents ? Il semblerait que la catégorie de « nouveaux blessés », que Catherine Malabou (2017) réservait aux patients atteints de dommages cérébraux, sied à merveille à l’homme contemporain. Mais que faut-il entendre par cette expression ? Qui sont ces « nouveaux blessés » ? Laissons la parole à la philosophe : « Les accidents de la cérébralité sont des blessures qui déchirent le fil d’une histoire, la mettent hors d’elle, en suspendent le cours et demeurent « irrécupérables » du point de vue de l’interprétation, alors même que le psychisme continue de vivre. L’accident cérébral révèle ainsi la capacité d’un sujet de survivre à l’absence de sens de ses accidents » (Malabou, 2017, p. 21). Et puisque le passé se trouve biologiquement mis hors-jeu, alors la psychanalyse se trouve tout à fait démunie face à ces traumatismes contemporains ; par analogie, une société liquide dont l’origine se perd dans la succession sans terme des innovations ne peut recourir à l’histoire pour ressaisir son identité perdue. Que ce soit au niveau individuel ou sur le plan collectif, le récit et le pouvoir des mots s’effacent devant l’impératif vital d’une adaptation au temps présent.
C’est précisément ici, à notre sens, qu’entre en scène la résilience. Face à l’angoisse générée par la perspective de l’effondrement (énergétique, économique, climatique, etc.), face à l’insécurité née de la disparition des repères stables qu’offrait encore la période moderne, face à la pression résultant de l’accélération sociale, face à la disparition de l’origine et de l’identité qui conféraient sens à l’existence et à l’action, elle offre un nouveau récit progressiste débarrassé de toute philosophie de l’histoire, elle secrète de nouveaux modèles de réussite qui parviennent, tant bien que mal, à surmonter les accidents de la condition postmoderne. Entendons Boris Cyrulnik (2002) narrer l’histoire (histoire qui ne se confond jamais pour lui avec le destin : la résilience s’oppose résolument à la conception tragique de l’existence) de ces enfants qui, en raison de leurs « nourritures affectives », parviennent à sortir de l’ornière des bombardements, des prises d’otage, de l’émigration ou encore de la maltraitance : tout lecteur en conclut derechef qu’il peut toujours exister une issue dans un monde sans issues, un recours dans une société sans recours, que, en somme, « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ». Même son de cloche du côté de la « résilience écologique » : André Dauphiné et Damienne Provitolo (2007), géographes promouvant la notion de résilience dans leur discipline, prennent l’exemple des Pays-Bas qui, plutôt que de continuer à construire des digues qui de toute façon finissent un jour ou l’autre par céder, ont construit une stratégie visant à laisser les terres basses se faire inonder afin de remplir les nappes sous-terraines et de revivifier les espaces intérieurs. Ici également, la nature n’est pas une fatalité si les décideurs acceptent de ne plus l’affronter de front (la construction de barrages) mais de penser en termes de système et d’équilibre.
Par voie de conséquence, il apparaît que la résilience constitue un récit de substitution aux philosophies de l’histoires mortes et enterrées avec le XXe siècle. Ce récit, privé de téléologie, diffère assez significativement des précédentes narrations. Néanmoins, s’il ne prétend plus englober l’histoire humaine, force est pourtant d’observer qu’il fait preuve d’omniprésence voire d’ubiquité puisqu’il concerne à la fois la nature, le psychique et le social, l’individuel et le collectif, etc. D’où provient donc cette impressionnante qualité ? Il est temps d’entamer notre analyse conceptuelle de la résilience.
2. Ce que l’on appelle « résilience »
Le caractère générique et ubiquitaire de la résilience, soulevé dans l’introduction de cet article, se reflète dans la multiplicité des cadres théoriques forgés en vue de saisir sa nature, son rôle et ses effets. Serge Tisseron (2017) en retrace l’histoire, et met en exergue comment chaque discipline a pu proposer ses propres élaborations du concept : il distingue ainsi le modèle des stratégies adaptatives issues des travaux de la pionnière Emmy Werner, l’étude du rôle de la personnalité et de son interaction l’environnement, la mise en évidence de l’importance de l’attachement dans le développement d’une capacité de résilience, l’analyse du processus de fabrique du sens, les travaux portant sur l’apprentissage, les apports de la neurobiologie, etc., cette liste ne possédant pas de caractère exhaustif.
Faut-il alors renoncer à unifier le concept de résilience et, pour l’utiliser, pour le mobiliser dans le cadre d’une étude scientifique, opter pour l’un de ces positionnements et renoncer voire s’opposer aux autres ? Une réponse positive aurait pour conséquence une singulière situation caractérisée par la tension entre la dimension englobante de la résilience du point de vue médiatique et son caractère fractionné dans le champ scientifique. Serge Tisseron (2017, p. 109), qui nous semble refléter ici le pragmatisme ambiant, ne se résout pas à cette contradiction : pour lui, « en effet, une fois défini dans la polyvalence de ses acceptions, il permet de penser sous un concept unique un grand nombre de bouleversements que nous traversons, un peu comme celui de « Renaissance » désigne ceux qui ont affecté l’Europe entre 1450 et 1550 ». Quelle est donc cette unicité ? La résilience renverrait, toujours selon le même auteur, à la mobilisation des ressources, individuelles et collectives, en vue de surmonter les épreuves de tous types grâce à la conception et à la mise en œuvre de nouveaux projets.
Avouons qu’une telle définition, lâche, vague, générale, laisse le lecteur acribique quelque peu dubitatif. À tort, à notre sens : car l’attente de définition de la résilience émane de la croyance en la possibilité intellectuelle d’en faire un concept, alors même qu’elle ne s’y prête guère, elle qui n’aspire qu’à une transformation de la réalité. Serge Tisseron (2017, p. 40) le confesse volontiers : « […] si l’on veut tenter de penser la résilience autrement que comme un mot à tout faire, le mieux est sans doute de la considérer comme une sorte de grande boîte à outils dans laquelle chacun apporterait les siens. Ce qui importe alors, ce n’est pas que le modèle soit rigoureux mais qu’il soit opératoire ». Voilà qui est avoué : la résilience n’est pas un système théorique qui doit être éprouvé en fonction de sa cohérence et de sa pertinence – caractères traditionnels de la vérité –, mais un ensemble d’outils dont la seule validité est celle de l’épreuve du « terrain » : l’efficacité. Elle apparaît alors, selon l’expression de Thierry Ribault (2021, p. 31), comme « le couteau suisse de la société industrielle ».
Cet acquis est loin d’être neutre : il explique la frénésie de modélisation que l’on rencontre dans les ouvrages et les articles consacrés à la résilience. À la suite des innombrables courbes du deuil et des multiples formalisations des étapes du changement, la résilience se prête également au jeu sans fin de la modélisation. Jeu sans fin, en effet : puisqu’un modèle ne vaut qu’en raison de son efficacité, de sa valeur opératoire, il peut toujours être amendé, complété, modifié, par exemple par l’introduction d’une nouvelle variable ou encore par la mise en évidence d’un nouveau lien, etc. À titre d’exemple, Guy Konincks et Gilles Teneau (2010, p. 89-128) présentent dans le chapitre de leur ouvrage Résilience organisationnelle le modèle CRC (Crise-Résilience-Changement) qui repose sur une décomposition du processus en phases, sur la distinction entre plusieurs formes de résilience (qui font écho aux différents types d’apprentissage), sur l’identification des conditions favorables à l’émergence de la résilience, etc.
La découverte et la compréhension de ces modèles de la résilience contribuent à la formulation de la remarque suivante, simple dans son expression, mais lourde de sens quant à ses corollaires : ces modèles s’appliquent aussi bien à l’individu qu’à une entreprise voire à un territoire. Au fond, les multiples adjectifs dont se pare la résilience proviennent, au-delà de l’irréfutable succès de son imaginaire, de l’impérialisme de la modélisation qui s’adresse et s’applique à tout système, quel qu’il soit ; en témoigne cette citation extraite du Petit traité de résilience locale dont les auteurs sont des spécialistes de l’étude de l’effondrement (« collapsologie ») : « La résilience est cette capacité qu’a un système de maintenir ses principales fonctions malgré les chocs, y compris au terme d’une réorganisation interne. Que le système soit la société, la ville, la maison ou nous-mêmes, les principes sont sensiblement les mêmes. La résilience peut être collective (territoriale) ou individuelle (psychologique) » (Sinaï et al., 2015, p. 16). Par la résilience s’établit un continuum naturaliste qui s’étend de l’individu et de son psychisme jusqu’à la planète et son développement durable : se produit alors un nivellement ontologique qui réduit le réel à un ensemble de systèmes, à un système de systèmes, au détriment de la singularité métaphysique des entités considérées. La réticence des psychanalystes à l’endroit de la notion de résilience tient à notre sens à cet arasement qui fait fi, entre autres, de la disposition principiellement langagière de l’être humain.
Où en sommes-nous de notre raisonnement ? Il apparaît à présent obvie que la résilience tient son unité, non pas d’une unification d’un cadre théorique, mais de son pouvoir opératoire qu’elle tient de sa nature modélisée et modélisatrice. Néanmoins, notre étiologie serait incomplète si elle s’en limitait à cette analyse synchronique ; il convient de lui adjoindre une perspective généalogique qui nous introduise à deux éléments supplémentaires et incontournables : d’une part, le fonds commun ou le socle fondamental à partir duquel se déploie la compréhension contemporaine de la résilience dans les différentes disciplines scientifiques ; d’autre part, les connotations et les imaginaires que ces mêmes disciplines importent, parfois même à leur insu, en même temps que le « concept ».
En la matière, c’est le très beau travail d’Amélie Nillus, son mémoire de Master 1 intitulé Généalogie du concept de résilience, qui nous sert de guide ; car il s’agit, à notre sens, de l’étude conceptuelle la plus sérieuse menée sur ce sujet.
Si l’étymologie latine du terme (resilere) dirige l’interprétation dans deux directions, d’une part celle du saut en arrière, d’autre part celle de la rétractation (comme dans le cas de la résiliation d’un contrat), force est toutefois de constater que son utilisation scientifique est liée à la Révolution industrielle et au développement des sciences modernes qui y sont associées. La physique des matériaux fait office de pionnière : ici, la résilience désigne en premier lieu l’une des formes de résistance à une action externe, sens que l’on peut encore déceler derrière les expériences de crash test automobile. Il s’agit plus précisément de situer le point de non-retour du matériau étudié, car la contrainte trop forte vient à bout de la résistance et conduit à la fracture. Toutefois, comme le précise utilement Amélie Nillus, pour Thomas Young qui le premier utilise le terme de résilience, il existe deux types d’action externe et deux types de réaction associée : d’une part, la pression constante qui met à l’épreuve la solidité du matériau, d’autre part, l’impulsion qui sollicite la capacité de résilience du corps concerné. En d’autres termes, dès ses origines, la résilience désigne un type de réaction bien identifié qui correspond à l’aptitude à faire face à un choc, c’est-à-dire à une force soudaine qui déstabilise l’équilibre du repos et de la pression constante. De telle sorte que l’urgence, sa temporalité, sa violence, paraît consubstantielle au concept de résilience.
Une telle définition de la résilience ouvre alors la porte à deux voies de recherche principales. La première s’enquiert des conditions extérieures, étudiant les différents types de force, les variétés d’impact, s’attachant à dégager des idéaux-types situationnels. La seconde, quant à elle, portera à rebours sur l’analyse des propriétés et des formes des matériaux. En particulier, Henry Moseley s’attachera à mettre en évidence l’élasticité des corps, c’est-à-dire leur capacité à retrouver leur position après avoir subi une déformation due à l’action d’une force externe. Cette évolution est importante, car elle impose encore largement à la résilience son sens contemporain : ce n’est plus en effet la fracture qui constitue la point-limite du matériau résilient, mais l’impossibilité de retrouver sa forme originelle.
C’est en premier lieu de cette propriété élastique, et notamment celle des poumons, dont s’empare la biologie du XIXe siècle. Malléable, l’organe respiratoire retrouve sa forme après chaque expiration : de ce point de vue, la résilience recouvre parfaitement la définition qu’en donnait la physique des matériaux. Relativement discret durant le XIXe siècle, le concept va alors s’enrichir d’une nouvelle dimension qui se substitue à la notion physique de résistance : celle de l’adaptation qui traduit la permanence des fonctions biologiques indispensable à la survie de l’organisme, ainsi que le maintien de l’équilibre corporel, que Walter Cannon baptisera plus tard du nom « homéostasie ». Comme le rappelle Amélie Nillus, Herbert Spencer est l’un des premiers à explorer cette veine, mais le concept sera repris dans les études portant sur le stress (« syndrome général d’adaptation ») et également étendu aux problématiques écologiques.
Que retenir de ce bref descriptif généalogique de la résilience ? De quelles couches sédimentaires cette dernière est-elle déjà chargée lorsqu’elle émigre vers la psychologie et les sciences humaines ? Il nous semble que les trois éléments suivants constituent le noyau commun de la résilience : tout d’abord, la résilience est la réaction à une force soudaine et intense (un décès, un cyclone, une fusion, etc.) ; ensuite, elle désigne une aptitude à l’élasticité du système concerné, que celui-ci retrouve son fonctionnement initial ou qu’il en invente de nouvelles modalités (phénomène d’apprentissage) ; enfin, elle représente la dynamique même de l’adaptation à l’environnement et à ses multiples dimensions et contraintes. Bref, elle est, au fond, l’autre nom de l’avantage sélectif.
3. Résilience et organisation : l’impératif de l’adaptation
Il est temps de rapatrier la réflexion sur le terrain du management : après avoir établi que la résilience offre un nouveau récit progressiste à l’époque de la mort de Dieu, après avoir relevé les connotations qu’elle charrie en raison de son histoire sinueuse tissée d’emprunts et de transferts, nous envisageons à présent sa place dans le domaine des sciences de l’organisation.
De ce point de vue, la résilience nous semble correspondre à une réactualisation de l’approche systémique. Cela est tout d’abord vrai d’un point de vue opérationnel car les méthodologies préconisées recommandent toutes d’identifier les paramètres en jeu, leurs interrelations, le lien de l’organisation avec son environnement, son mode de fonctionnement à l’équilibre, etc. Mais cela se constate également quand les auteurs partent en quête de fondements théoriques à la résilience : ainsi Guy Koninckx et Gilles Teneau (2010, p. 31 sq) se réfèrent-ils non seulement à la Théorie générale des systèmes du biologiste allemand Ludwig von Bertalanffy, qui étudie la régulation homéostatique des systèmes ouverts, mais également aux travaux d’Ilya Prigogine qui mettent en évidence la possibilité pour un système de survivre loin de son point d’équilibre initial. Dans les deux cas, l’approche systémique substitue à la simplicité de la causalité linéaire la complexité d’une étiologie circulaire et multifactorielle ; elle vise en outre à s’assurer que les stratégies choisies se trouvent en adéquation avec la nature de l’environnement.
Autre exemple de notre thèse : l’un des auteurs phare écrivant sur la résilience, qui est un aussi un grand nom des sciences de l’organisation, n’est autre que le socio-psychologue Karl Weick. Pour ce dernier, qui s’inspire directement des travaux du cybernéticien anglais Ross Ashby, un système ne peut pas traiter la complexité issue de l’environnement s’il ne possède pas lui-même, en, interne, un niveau de complexité comparable : telle est la loi de la « variété requise ». Il s’agit alors de promouvoir les interactions afin de pouvoir établir un cadre cognitif commun minimal permettant de s’adapter en temps réel aux situations imprévues. La convergence des représentations se trouve ainsi à l’origine du processus de résilience.
Ce qui transparaît à travers les propos précédents, qui font état de l’arrière-fond systémique de la résilience, c’est que la finalité d’un système, d’une organisation en l’occurrence, se résume à sa survie, c’est-à-dire, en dernier ressort, à sa capacité d’adaptation. C’est bien ce qui ressort du tour d’horizon des définitions de la résilience que proposent Guy Koninckx et Gilles Teneau (p. 20 sq) : pour Boris Cyrulnik, elle est « la capacité à réussir à vivre et à se développer de manière acceptable en dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative » ; pour Sophie Martin, elle désigne « la capacité d’un système à pouvoir intégrer dans son fonctionnement une perturbation, sans pour autant changer de structure qualitative » ; pour Alain Richemond, « c’est la capacité de retomber sur ses pieds, de garder le cap, d’assurer la pérennité d’un organisme ou d’une société, le maintien d’une certaine permanence dans un environnement turbulent ». Inutile de multiplier les extraits : une organisation n’est pas envisagée sous un angle civilisationnel, c’est-à-dire dans son possible apport à l’histoire de l’humanité et de ses réalisations, mais dans la seule perspective de sa survie, comme si cette dernière constituait une finalité en soi.
Élargissons à présent le propos : la résilience connaît autant de succès dans les milieux managériaux, car les sciences de l’organisation se sont largement bâties sur l’héritage de la biologie moderne. C’est en tout cas ce que nous pensons avoir démontré dans les deux premiers volumes de notre Théologie de l’Organisation (Rappin, 2014, 2018) qui reviennent sur la constitution progressive du concept scientifique d’organisation, tout d’abord chez Lamarck et Cuvier, pionniers de la biologie moderne, puis dans le tournant cybernétique des années 1940.
Il faut tout d’abord saisir l’enjeu idéologique et stratégique du concept d’organisation. De même que, chez Kant, la loi morale réside dans l’accès à l’autonomie par le travail de la raison pratique qui s’émancipe de toutes les formes d’extériorité, de même le vivant, pour les modernes, doit être pensé sans recours à la théologie ou à la téléologie, en toute autonomie, en ne se référant qu’à lui-même. L’organisation est précisément le concept qui a permis cet affranchissement : l’organisme est désormais une totalité constituée d’éléments interdépendants orientée vers le maintien de l’équilibre homéostatique dont l’horizon est la survie. Cette dernière deviendra encore plus cruciale, encore plus décisive, avec l’introduction, par Darwin, de l’idée d’une compétition en quelque sorte aveugle entre des patrimoines génétiques soumis à la loi des mutations aléatoires. L’avantage sélectif, fitness en anglais, correspond par voie de conséquence à l’aptitude à s’adapter à un environnement changeant.
Ce qu’introduit la cybernétique dans ces schémas du XIXe siècle, c’est bien évidemment la notion d’information, à tel point que l’on pourrait définir l’organisation comme un ensemble organisé d’informations. Pour Norbert Wiener (2014, p. 50), « vivre, c’est vivre avec une information adéquate », si bien que la question de l’adaptation se déplace du hasard, le caractère aléatoire de la mutation génétique, vers le développement de capacités liées au traitement de l’information, ce que l’on appelait précisément apprentissage, déjà dans les années 1950 chez les cybernéticiens (chez Norbert Wiener bien sûr, mais également chez son ami Gregory Bateson par exemple) puis dans les sciences de l’organisation (avec Chris Argyris et Donal Schön, puis Peter Senge), et que nous désignons aujourd’hui comme résilience.
Par quel mécanisme ce traitement de l’information est-il optimal et concourt-il à la survie au sein de la nouvelle sélection, non plus naturelle mais cognitive ? La rétroaction, que l’on nomme encore « contrôle », est la clef : par elle, l’organisation peut soit se maintenir dans son homéostasie, soit enclencher, chemin faisant, une dynamique d’apprentissage qui passe par l’adoption de nouvelles méthodes voire par une redéfinition des finalités du système. Ce n’est pas un hasard que les mécanismes de régulation soient donc l’objet d’une attention particulière des théoriciens de la résilience : c’était déjà le cas en psychologie avec John Bowlby qui, dans son ouvrage de 1969, Attachment and Loss, utilise le concept d’homéostasie pour décrire l’équilibre des relations entre l’individu et son environnement : « In proposing the concept of a behavioural control system to account for the way a child maintains his relation to his attachment figure between certain limits of distance or accessibility, no more is done than to use these well-understood principles to account for a different form of homeostasis, namely one in which the set-limits concern the organism’s relation to features of the environment and in which the limits are maintained by behavioural rather than physiological means » (cité dans Nillus, 2018, p. 50) ; c’est encore le cas de Guy Koninckx et de Gilles Teneau (2010, p. 23) qui insistent sur les « mécanismes d’autorégulation » indispensables à l’organisme pour rétablir un équilibre mis à mal. Au fond, tant les outils formels du contrôle (des tableaux de bord aux référentiels de compétences) que le développement de relations informelles (comme l’intelligence collective) ont pour finalité de préparer l’organisation à se montrer résiliente en cas de secousse, étant entendu que les deuxièmes formes, théoriquement plus souples car délivrées de la rigidité de la codification, ont présentement le vent en poupe. Il n’est pas dit que les progrès en intelligence artificielle ne nous mènent pas vers un retour de balancier.
Pour conclure cette partie, nous pouvons affirmer que la résilience se trouve au cœur de la capacité des organisations contemporaines à s’adapter à leur environnement mouvant ; elle est, de ce point de vue, un indispensable avantage sélectif quand la concurrence se fait toujours plus intense et que le rythme de l’innovation est toujours plus soutenu. Elle repose sur la mise en place de mécanismes techniques et sociaux de régulation, d’autorégulation, qui prédisposent le système à réagir, vite et bien, à la crise qui le frappe.
CONCLUSION : derrière le management, la domination paradigmatique de la biologie moderne
Il n’est de généalogie du management qui ne puisse déboucher, d’une façon ou d’une autre, sur l’influence constitutive de la biologie moderne. Dans le cas présent, c’est la résilience qui nous servit de porte d’entrée. Mais prenons garde à ne pas considérer le management comme une exception, ou encore à le dissocier de l’évolution générale des sociétés dont il participe d’ailleurs largement.
C’est en effet tout le mérite du dernier ouvrage de Barbara Stiegler (2018) que de mettre en évidence que l’adaptation, loin de se réduire à un fait biologique, s’avère plus profondément un programme sociopolitique défendu par le néolibéralisme. Walter Lippmann est une figure fondatrice de ce courant de pensée ; il fut tout d’abord influencé par Graham Wallas, qui fut le théoricien de la Great Society et dont il suivit le séminaire à Harvard en 1910. Pour ce dernier, la révolution industrielle a complètement chamboulé les relations de l’homme et de son environnement, engendrant un décalage sans précédent qui ne peut plus être comblé par une adaptation, lente, graduelle et progressive, à la manière de l’évolutionnisme darwinien. Et contrairement à Herbert Spencer qui concevait l’adaptation de manière passive et subie, c’est-à-dire purement mécanique, Wallas assume que la tâche de la civilisation consiste justement à modifier l’environnement, à créer des conditions qui correspondent aux dispositions existantes et actuelles de l’homme. Le volontarisme supplante la passivité, l’adaptation change de cible : non plus l’être humain et ses capacités, mais son milieu.
Voici un renversement de perspective qui retient toute l’attention de Walter Lippmann et justifie son projet d’une démocratisation de la société industrielle dont l’horizon est la coopération ; mais il convient à cette fin de cesser de prendre le travailleur pour une simple force de travail, ce qui n’est rien d’autre que de le réduire au statut de machine, et plutôt de l’envisager comme un collaborateur, comme un partenaire – une « partie prenante » dirait-on de nos jours – qui fait partie intégrante de la fabrique de l’intelligence collective. Mais ce programme revient à changer les mentalités des organisations industrielles : le rôle de l’éducation y est par conséquent prépondérant, mais non plus entendue à la façon des Lumières comme le processus de formation du jugement, mais bien comme l’acquisition d’une nouvelle façon d’agir et de se comporter dans la nouvelle société des grands ensembles industriels.
Notons en outre qu’Elton Mayo, dans son plaidoyer pour une civilisation industrielle, épouse parfaitement ce raisonnement. Le psychologue, s’appuyant sur les sociologues Frédéric Le Play et Émile Durkheim, assure que le progrès industriel possède comme revers un déclin de la coopération et une hausse de l’hostilité entre les groupes. Pourquoi ? Mayo attribue l’origine de cette carence au décalage existant entre l’évolution technique et le développement des compétences sociales ; si la révolution industrielle apporta son lot d’innovations, matérielles et organisationnelles, les sciences humaines quant à elles manquèrent à leur mission de formation d’hommes capables de vivre dans ce nouveau type de société. Si bien que l’homme contemporain se trouve inadapté à son nouvel environnement, ce qui ne manque pas d’amener frustrations et conflits. Voici pourquoi « la collaboration dans une société industrielle ne peut être laissée au hasard […] car une telle négligence ne peut que conduire à la perturbation voire à la catastrophe » (Mayo, 1975, p. 8-9). L’industrie ayant brisé les cadres traditionnels et naturels de la coopération, il convient de prendre en main le processus de collaboration faute de quoi la société pourrait s’acheminer vers sa dissolution et sa disparition : tel est précisément le rôle des sciences humaines, et notamment de l’anthropologie, que de fabriquer scientifiquement et artificiellement l’adaptation aux nouvelles conditions de vie.
On le constate : comprendre la résilience nécessite de la replacer au sein de l’histoire du séisme que fut la révolution industrielle, ainsi que de ses multiples répliques que nous ressentons encore actuellement, par exemple sous l’expression de « transformation digitale de la société ». On notera enfin, pour terminer notre réflexion et ouvrir un horizon d’études comparatives, que la biologie n’a pas servi de fondement au seul néolibéralisme : l’historien Johann Chapoutot (2018) a remarquablement montré comment le culte de la performance (die Leistung) du régime national-socialiste s’abreuvait aux mêmes sources.
Baptiste RAPPIN, le 16 octobre 2023
Article tiré du colloque de novembre 2019
Références bibliographiques
BAUMAN Z., (2006), La vie liquide, trad. Christophe Rosson, Rodez, Le Rouergue / Chambon, « Essai ».
BECK U., (2001), La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad. Laure Bernardi, Paris, Flammarion, « Champs ».
CHAPOUTOT J., (2018), Comprendre le nazisme, Paris, Tallandier.
CYRULNIK B., (2002), Un merveilleux malheur, Paris, Éditions Odile Jacob.
DAUPHINÉ A., PROVITOLO D., (2007), « La résilience : un concept pour la gestion des risques », Annales de Géographie, n°654, p. 115-125.
KONINCKX G., TENEAU G., (2010), Résilience organisationnelle. Rebondir face aux turbulences, Bruxelles, Éditions De Boeck, « Manager RH ».
LYOTARD J.-F., (1979), La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Éditions de Minuit, « Critique ».
MALABOU C., (2017), Les nouveaux blessés. De Freud à la neurologie, penser les traumatismes contemporains, Paris, Presses Universitaires de France, « Quadrige ».
MAYO E., (1975), The social problems of an industrial civilization, London, Routledge & Kegan Paul, « International Library of Sociology ».
NILLUS A., (2018), Généalogie de la résilience, Mémoire de Master 1 « Histoire de la Philosophie », soutenu à l’ENS Lyon sous la direction du Professeur Samuel Leze.
RAPPIN B., (2014), Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, volume I, Nice, Éditions Ovadia, « Chemins de pensée ».
RAPPIN B., (2018), De l’exception permanente. Théologie de l’Organisation, volume II, Nice, Éditions Ovadia, « Les carrefours de l’être ».
ROSA H., (2010), Accélération. Une critique sociale du temps, trad. Didier Renault, Paris, Éditions La Découverte, « Théorie critique ».
SERVIGNE P., STEVENS R., (2015), Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Éditions du Seuil, « Anthropocène ».
SINAÏ A., STEVENS R., CARTON H., SERVIGNE P., (2015), Petit traité de résilience locale, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer.
STIEGLER B., (2019), « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, Éditions Gallimard, « nrf essais ».
TISSERON S., (2017), La résilience, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».
WIENER N., (2014), Cybernétique et société. L’usage humain des êtres humains, trad. Pierre-Yves Mistoulon, Paris, Éditions du Seuil, « Sci

Mots-clés
géopolitiquegouvernance
sécurité et liberté
Société
économie et histoire
Conditions de travail
Asie
Europe
Etats-Unis
Questions de « sens »
Industrie
souveraineté
mondialisation
Notes
[1] Eloi Laurent. Sortir de la croissance. Mode d’emploi. p.104. LLL, 2021)
HISTOIRE D’UNE RÉSILIENCE. Recension : Japon, l’envol vers la modernité, ouvrage de P.A. Donnet
LA RUSSIE A-T-ELLE LES MOYENS DE VAINCRE EN 2024 ? Michel FOUQUIN
JACQUES DELORS, L’EUROPEEN. Par Jean-Marc SIROËN
LE GEOINT MARITIME, NOUVEL ENJEU DE CONNAISSANCE ET DE PUISSANCE. Philippe BOULANGER
INTERDÉPENDANCE ASYMÉTRIQUE ET GEOECONOMICS. Risque géopolitique et politique des sanctions
VERS DES ÉCHANGES D’ÉNERGIE « ENTRE AMIS » ? Anna CRETI et Patrice GEOFFRON
LA FIN DE LA SECONDE MONDIALISATION LIBÉRALE ? Michel FOUQUIN
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (I)
DE LA FRAGMENTATION À L’INSTALLATION D’UN « DÉSORDRE » MONDIAL (II)
DÉMOCRATIE et MONDE GLOBALISÉ. À propos de la « Grande Expérience » de Yascha Mounk
ART ET DÉNONCIATION POLITIQUE : LE CAS DE LA RDA. Elisa GOUDIN-STEINMANN
ET SI LE RETOUR DE L’INFLATION ÉTAIT UN ÉVÈNEMENT GÉOPOLITIQUE ? Sylvie MATELLY
LES NEUTRES OPPORTUNISTES ONT EMERGÉ. Thomas Flichy de la Neuville
LE GROUPE DE BLOOMSBURY ET LA GUERRE. CONVICTIONS ET CONTRADICTIONS. Par Jean-Marc SIROËN
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, AVENIR DE L’INDUSTRIE ? Par Nadine LEVRATTO
UKRAINE. « IL FAUDRAIT PROCÉDER À UNE REFONTE DES TRAITÉS QUI RÉGULENT LA SÉCURITE EUROPÉENNE »
 NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
NE PAS SE SOUMETTRE À L’HISTOIRE. IMPRESSIONS DE « DÉJA VU »
 LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
LA MONDIALISATION A ENGENDRÉ UNE CONFLICTUALITÉ PERMANENTE. Par Raphaël CHAUVANCY
ÉTHIQUE NUMERIQUE ET POSTMODERNITÉ. Par Michel MAFFESOLI
UNE MONDIALISATION À FRONT RENVERSÉ
LES DESSOUS GÉOPOLITIQUES DU MANAGEMENT. Par Baptiste RAPPIN
LE COVID-19 S’ENGAGE DANS LA GUERRE MONDIALE DES VALEURS. Par J.P. Betbeze
LE MULTILATERALISME EN QUESTION. Par Philippe MOCELLIN
« LE VRAI COUPABLE, C’EST NOUS » !
VIVE L’INCOMMUNICATION. Par Dominique WOLTON
LES SENTIERS DE LA GUERRE ECONOMIQUE. Par NICOLAS MOINET
LE RETOUR DES NATIONS... ET DE L’EUROPE ?
LES FUTURS POSSIBLES DE LA COOPERATION FRANCO-ALLEMANDE. Claire DEMESMAY
GEOPOLITIQUE DE LA PROTECTION SOCIALE. Julien DAMON
L’ACTUALITE DE KARL POLANYI. Par Nadjib ABDELKADER
« LE MONDE D’AUJOURD’HUI ET LE MONDE D’APRES ». Extraits de JEAN FOURASTIE
VERS UNE CONCEPTION RENOUVELÉE DU BIEN COMMUN. Par F. FLAHAULT
« POUR TIRER LES LEÇONS DE LA CRISE, IL NOUS FAUT PRODUIRE MOINS ET MIEUX ». Par Th. SCHAUDER
AVEUGLEMENTS STRATEGIQUES et RESILIENCE
LE CAPITALISME et ses RYTHMES, QUATRE SIECLES EN PERSPECTIVE. Par Pierre Dockès
NATION et REPUBLIQUE, ALLERS-RETOURS. Par Gil DELANNOI
L’INDIVIDU MONDIALISE. Du local au global
LE DEFI DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE par N. Moinet
De la MONDIALISATION « heureuse » à la MONDIALISATION « chute des masques »
Lectures GEOPOLITIQUES et GEOECONOMIQUES
QUAND le SUD REINVENTE le MONDE. Par Bertrand BADIE
L’ETAT-NATION N’EST NI UN BIEN NI UN MAL EN SOI". Par Gil Delannoi
LA MONDIALISATION et LA SOUVERAINETE sont-elles CONTRADICTOIRES ?
SOLIDARITE STRATEGIQUE et POLITIQUES D’ETAT. Par C. Harbulot et D. Julienne
La gouvernance mondiale existe déjà… UN DIALOGUE CRITIQUE AVEC B. BADIE
LA LITTERATURE FAIT-ELLE DE LA GEOPOLITIQUE ?
PENSER LA GUERRE AVEC CLAUSEWITZ ?
L’expression GUERRE ECONOMIQUE est-elle satisfaisante ?
LA GEOPOLITIQUE et ses DERIVES
A propos d´un billet de Thomas Piketty
Conférence de Bertrand Badie : Les embarras de la puissance (9 février 2014)
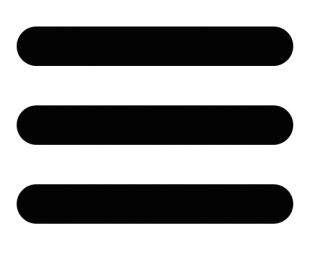

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
 LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER
LA BATAILLE DES BATTERIES ÉLECTRIQUES NE FAIT QUE COMMENCER. Par Stéphane LAUER