L’ESPACE, OUTIL GÉOPOLITIQUE JURIDIQUEMENT CONTESTÉ. Quentin GUEHO
TRIBUNE - FACE À UNE CHINE BÉLLIQUEUSE, LE JAPON JOUE LA CARTE DU RÉARMEMENT. Pierre-Antoine DONNET
DU DROIT DE LA GUERRE DANS LE CONFLIT ARMÉ RUSSO-UKRAINIEN. David CUMIN
ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC EMMANUEL LINCOT sur la Chine et l’Asie centrale. « LE TRÈS GRAND JEU »
ENTRETIEN AVEC HAMIT BOZARSLAN. DE L’ANTI-DÉMOCRATIE À LA GUERRE EN UKRAINE
ENTRETIEN EXCLUSIF - LE MULTILATERALISME AU PRISME DE NATIONS DESUNIES. Julian FERNANDEZ
L’AFRIQUE ET LA CHINE : UNE ASYMÉTRIE SINO-CENTRÉE ? Thierry PAIRAULT
L’INDO-PACIFIQUE : UN CONCEPT FORT DISCUTABLE ! Thierry GARCIN
L’ALLIANCE CHIP4 EST-ELLE NÉE OBSOLÈTE ? Yohan BRIANT
BRETTON WOODS ET LE SOMMET DU MONDE. Jean-Marc Siroën
LES ENJEUX DE SÉCURITE DE L’INDE EN ASIE DU SUD. Olivier DA LAGE
LA CULTURE COMME ENJEU SÉCURITAIRE. Barthélémy COURMONT
L’ARCTIQUE ET LA GUERRE D’UKRAINE. Par Thierry GARCIN
LA REVANCHE DE LA (GEO)POLITIQUE SUR L’ECONOMIQUE
UKRAINE. CRISE, RETOUR HISTORIQUE ET SOLUTION ACTUELLE : « LA NEUTRALISATION ». Par David CUMIN
VLADIMIR POUTINE : LA FIN D’UN RÈGNE ? Par Galia ACKERMAN
 « LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
« LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
 L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
LES MIRAGES SÉCURITAIRES. Par Bertrand BADIE
 LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
UNION EUROPÉENNE : UNE SOLIDARITÉ TOURNÉE VERS UN PROJET DE PUISSANCE ? Par Joséphine STARON
LES TALIBANS DANS LA STRATÉGIE DIPLOMATIQUE DE LA CHINE. Par Yohan BRIANT
🔎 CHINE/ETATS-UNIS/TAÏWAN : LE TRIANGLE INFERNAL. Par P.A. Donnet
LA RIVALITÉ CHINE/ÉTATS-UNIS SE JOUE ÉGALEMENT DANS LE SECTEUR DE LA HIGH TECH. Par Estelle PRIN
🔎 LES « MÉTAUX RARES » N’EXISTENT PAS... Par Didier JULIENNE
🔎 L’ARCTIQUE DANS LE SYSTÈME INTERNATIONAL. Par Thierry GARCIN
LES PARAMÈTRES DE LA STRATÉGIE DE DÉFENSE DE L’IRAN. Par Tewfik HAMEL
🔎 LES NOUVELLES GUERRES SYSTEMIQUES NON MILITAIRES. Par Raphaël CHAUVANCY
L’INTERNATIONALISME MÉDICAL CUBAIN AU-DELÀ DE L’ACTION HUMANITAIRE. Par G. B. KAMGUEM
UNE EUROPE TRIPLEMENT ORPHELINE
LA DETTE CHINOISE DE DJIBOUTI. Par THIERRY PAIRAULT
CONSEIL DE SECURITE - L’AFRIQUE EST-ELLE PRÊTE POUR PLUS DE RESPONSABILITÉ ?
COMMENT LA CHINE SE PREPARE POUR FAIRE FACE AU DEUXIEME CHOC ECONOMIQUE POST-COVID. Par J.F. DUFOUR
GUERRE ECONOMIQUE. ELEMENTS DE PRISE DE CONSCIENCE D’UNE PENSEE AUTONOME. Par Christian HARBULOT
LA CRISE DU COVID-19, UN REVELATEUR DE LA NATURE PROFONDE DE L’UNION EUROPEENNE. Par Michel FAUQUIER
(1) GEOPOLITIQUE D’INTERNET et du WEB. GUERRE et PAIX dans le VILLAGE PLANETAIRE. Par Laurent GAYARD
La GEOPOLITIQUE DES POSSIBLES. Le probable sera-t-il l’après 2008 ?
« Une QUADRATURE STRATEGIQUE » au secours des souverainetés nationales
L’Europe commence à réagir à l’EXTRATERRITORIALITE du droit américain. Enfin ! Par Stephane LAUER
LA DEFENSE FRANCAISE, HERITAGE ET PERPECTIVE EUROPEENNE. Intervention du Général J. PELLISTRANDI
L’EUROPE FACE AUX DEFIS DE LA MONDIALISATION (Conférence B. Badie)
De la COMPETITION ECONOMIQUE à la GUERRE FROIDE TECHNOLOGIQUE
ACTUALITES SUR L’OR NOIR. Par Francis PERRIN
TRUMP REINVENTE LA SOUVERAINETE LIMITEE. Par Pascal Boniface
Une mondialisation d’Etats-Nations en tension
MONDIALISATION HEUREUSE, FROIDE et JEU DE MASQUES...
RESISTANCE DES ETATS, TRANSLATION DE LA PUISSANCE
Ami - Ennemi : Une dialectique franco-allemande ?
DE LA DIT A LA DIPP : LA FRAGMENTATION DE LA...
Conférence de Pierre-Emmanuel Thomann : La rivalité géopolitique franco-allemande (24 janvier 2017)
Conférence d’Henrik Uterwedde : Une monnaie, deux visions (20 janvier 2016)
Conférence de Bertrand Badie : Les fractures moyen-orientales (10 mars 2016)
LES THEORIES DES RELATIONS INTERNATIONALES AUJOURD’HUI. Par D. Battistella
lundi 19 février 2018 Dario BATTISTELLA
Dario Battistella (1), Professeur de Science Politique à Sciences Po Bordeaux, vous propose dans cet article de faire le point sur les théories des relations internationales : des origines tardives dans la pensée politique à l’état des lieux contemporain (entre internationalistes idéalistes, réalistes « triomphants » et approches contestataires...). Patrick Lallemant
(1) Auteur notamment de ‘Théories des R.I’, Presses de Sciences Po, 2015, 5e édition. Vous êtes également invités à visiter le site de l’auteur https://dariobattistella.fr/
Les théories des relations internationales aujourd’hui
Définies comme l’ensemble des relations qu’entretiennent les acteurs sociaux au-delà des limites de leurs unités collectives d’appartenance considérées individuellement, les relations internationales font l’objet de réflexions savantes depuis l’Antiquité tant grecque (Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse) qu’orientale (Sun Tzu, L’art de la guerre ; Kauytilia, Arthashastra). Elles n’en ont pas moins occupé un place relativement mineure dans l’histoire de la pensée politique : si quelques rares auteurs leur ont consacré leur chef-d’œuvre (Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix ; Carl von Clausewitz, De la guerre), les grands noms de la philosophie politique ne leur ont dédié qu’un écrit quantitativement marginal (J.J. Rousseau, Fragments sur l’état de guerre ; D. Hume, Of the Balance of Power ; E. Kant, Essai sur la paix perpétuelle), voire ne les ont abordées que sur quelques pages de leur ouvre majeure (N. Machiavel, Le Prince ; T. Hobbes, Léviathan ; J. Locke, Traité sur le gouvernement civil).
Ce n’est qu’en 1919 que le mécène gallois David Davies finance la première chaire de politique internationale au University College of Wales à Aberystwyth. Depuis il existe une discipline académique des Relations internationales caractérisée par un accord majoritaire sur les deux ingrédients indispensables à toute discipline scientifique, à savoir l’objet d’étude et la méthode à mettre en œuvre pour l’analyser. Pour ce qui est de l’objet d’étude, les internationalistes partent de l’hypothèse que les relations internationales se déroulent en état d’anarchie, au sens d’absence d’autorité centrale au-dessus des acteurs internationaux – qu’il s’agisse d’États, d’organisations internationales gouvernementales ou non-gouvernementales, d’entreprises, de réseaux de toute nature, voire d’individus. Pour ce qui est de la méthode la plus appropriée pour étudier cet objet, il y a consensus pour dire que la théorie scientifique susceptible de rendre compte en des termes abstraits des principes conducteurs des interactions politiques qui se déroulent au-delà des territoires nationaux part d’une intuition brillante, se fonde sur un raisonnement logique, et accepte de se confronter à la réalité empirique.
Reste que, justement, la réalité empirique est on ne peut plus fluctuante et évolutive. Le fait pour les relations internationales de se dérouler en état d’anarchie signifie en effet que l’on a affaire à des relations ayant lieu au sein d’une structure par définition vide, synonyme d’absence de quelque chose, en l’occurrence d’autorité centrale, et non pas de présence de quoi que ce soit a priori. Or, voilà qui ouvre, toutes choses égales par ailleurs, un spectre de possibilités infiniment plus large que la sphère politique interne, en principe régulée par la présence d’une instance revendiquant avec succès l’exercice du monopole de la violence physique légitime et limitant ipso facto les répertoires d’action à la disposition des acteurs. Conséquence : la discipline des Relations internationales est une discipline pluraliste ou, dans une perspective bourdieusienne, un champ scientifique, dans lequel coexistent et se succèdent des approches théoriques au succès d’autant plus précaire qu’il est lié à la génération et au contexte qui les ont vu émerger.
Ainsi, dans l’après-Première guerre mondiale, les premiers internationalistes, quasi exclusivement britanniques, sont des idéalistes : désireux de promouvoir la paix par l’étude scientifique des causes qui ont mené à la Première guerre mondiale, ils s’inspirent des idées de la paix par le « doux commerce » remontant à Montesquieu, par la démocratie proposée par Kant, et par le droit international cher aux jus naturalistes. Soutenant activement les efforts de la Société des Nations, ils subissent logiquement le contrecoup de l’échec de celle-ci : dès les années trente, des auteurs tels que, notamment, l’historien britannique Edward Carr (The Twenty Years’ Crisis 1919-1939), posent les fondements du réalisme, en affirmant tout à la fois que l’objet de la discipline consiste non pas à contribuer à la paix mais à comprendre la réalité de la politique internationale, et que ladite réalité est synonyme de politique de puissance.
La Seconde guerre mondiale, et a fortiori la Guerre froide, ouvrent alors la voie au triomphe du réalisme : comment ne pas voir dans l’affrontement bipolaire opposant les États-Unis à l’URSS une confirmation du postulat de base du réalisme – classique en l’occurrence autour de Hans Morgenthau (Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace) aux États-Unis et, en France, de Raymond Aron (Paix et guerre entre les nations) – selon lequel les relations internationales, assimilées à des relations interétatiques, sont un état de guerre sans fin entre grandes puissances ?
Certes, la période de détente qu’a connue la Guerre froide a ouvert une petite brèche dans la cuirasse réaliste, contestée d’abord par une poignée de néo-Marxistes analysant les relations Nord-Sud en termes de centre et de périphérie, puis par l’approche dite transnationaliste soulignant le rôle d’acteurs non-étatiques susceptibles de contourner les États, et voyant dans l’interdépendance entre sociétés un signe annonciateur du dépassement du système interétatique remontant aux Traités de Westphalie de 1648.
Mais la contre-attaque de l’Américain Kenneth Waltz (Theory of International Politics) a rétabli l’hégémonie réaliste dans sa version néo-réaliste, comme l’atteste le débat néoréalistes vs. néolibéraux des années quatre-vingt, avec les ex-transnationalistes autour de Robert Keohane (After Hegemony. Collaboration and Discord in the World Political Economy) se transformant en néolibéraux revenant dans le giron stato-centré dans l’espoir de mieux combattre les réalistes – de l’intérieur en quelque sorte.
Leur vœu a été exaucé suite à la fin de la guerre froide. Malgré eux ceci dit : en effet, la chute du Mur de Berlin n’a été prévue ni par les néo-réalistes (vu leur postulat de l’état de guerre sans fin entre superpuissances) ni par les néolibéraux (vu leur fixation sur la coopération entre économies occidentales). Conséquence : ce sont de nouvelles approches contestataires qui ont profité de la remise en cause de la discipline pour y faire entendre des voix dissidentes, et même poser la question qui tue : une connaissance un tant soit peu savante est-elle seulement possible en Relations internationales, ou bien le contexte de la vérité est-il à ce point fonction du contexte de la découverte que les théories ne sont in fine que des idéologies qui s’ignorent ?
Dans un premier temps, plusieurs théoriciens post-positivistes au sens large, influencés par Antonio Gramsci et l’École de Francfort, Michel Foucault et Jacques Derrida, Simone de Beauvoir et Edward Said, ont introduit les questionnements critiques, post-modernistes, post-coloniaux et de genre, dans une discipline jusque-là restée à l’abri de toute auto-réflexivité. Dans un deuxième temps, et suite au dialogue de sourds auquel a fini par aboutir la controverse théories mainstream vs. approches post-positivistes, le constructivisme social impulsé notamment par Alexander Wendt (Social Theory of International Politics) a proposé une sorte de synthèse entre épistémologie positiviste – il est possible d’étudier scientifiquement la réalité internationale – et ontologie post-positiviste – cette réalité n’est ni objective, ni subjective, mais intersubjective. Plus précisément, l’anarchie est ce que les acteurs en font : les relations internationales ne sont en soi ni politique de puissance, comme le soulignent les réalistes, ni état de coopération, comme l’affirment les idéalistes ou les libéraux ; elles sont l’un ou l’autre selon les identités partagées des acteurs en interaction : entre ennemis prévaut l’état de guerre, entre rivaux prévaut l’état de coopération ; entre amis prévaut l’état de solidarité.
Le constructivisme a eu un succès fulgurant auprès de la jeune génération d’internationalistes, avec pour conséquence aussi un éclectisme-pragmatisme en lieu et place du paradigmatisme synonyme de querelles entre écoles concurrentes qui caractérisait la discipline pendant le vingtième siècle. De nos jours, la recherche en Relations internationales est moins theory-driven que problem-driven : plutôt que de choisir leur question de recherche en vue de corroborer ou réfuter telle ou telle approche de la discipline ou de proposer une nouvelle grand theory, les jeunes chercheurs appliquent de façon plus pragmatique les concepts et modèles existants dans la discipline et aspirent à des middle-range theories susceptibles de contribuer à résoudre les problèmes que pose la réalité internationale.
La question reste ouverte de savoir s’il s’agit là d’un signe de maturation, de normalisation de la discipline, à l’image de ce que sont devenues les autres sciences sociales dans la foulée des sciences économiques, ou si l’on a affaire au contraire à la preuve de la résignation de ceux qui sont censés la faire vivre. Si la dialectique de Hegel a du vrai, l’actuelle ambition synthétique devrait tôt ou tard provoquer une contestation antithétique. Avis aux amateurs …
Dario Battistella (1), Professeur de Sciences Politiques à Sciences Po Bordeaux, le 19 février 2018
L’ESPACE, OUTIL GÉOPOLITIQUE JURIDIQUEMENT CONTESTÉ. Quentin GUEHO
TRIBUNE - FACE À UNE CHINE BÉLLIQUEUSE, LE JAPON JOUE LA CARTE DU RÉARMEMENT. Pierre-Antoine DONNET
DU DROIT DE LA GUERRE DANS LE CONFLIT ARMÉ RUSSO-UKRAINIEN. David CUMIN
ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC EMMANUEL LINCOT sur la Chine et l’Asie centrale. « LE TRÈS GRAND JEU »
ENTRETIEN AVEC HAMIT BOZARSLAN. DE L’ANTI-DÉMOCRATIE À LA GUERRE EN UKRAINE
ENTRETIEN EXCLUSIF - LE MULTILATERALISME AU PRISME DE NATIONS DESUNIES. Julian FERNANDEZ
L’AFRIQUE ET LA CHINE : UNE ASYMÉTRIE SINO-CENTRÉE ? Thierry PAIRAULT
L’INDO-PACIFIQUE : UN CONCEPT FORT DISCUTABLE ! Thierry GARCIN
L’ALLIANCE CHIP4 EST-ELLE NÉE OBSOLÈTE ? Yohan BRIANT
BRETTON WOODS ET LE SOMMET DU MONDE. Jean-Marc Siroën
LES ENJEUX DE SÉCURITE DE L’INDE EN ASIE DU SUD. Olivier DA LAGE
LA CULTURE COMME ENJEU SÉCURITAIRE. Barthélémy COURMONT
L’ARCTIQUE ET LA GUERRE D’UKRAINE. Par Thierry GARCIN
LA REVANCHE DE LA (GEO)POLITIQUE SUR L’ECONOMIQUE
UKRAINE. CRISE, RETOUR HISTORIQUE ET SOLUTION ACTUELLE : « LA NEUTRALISATION ». Par David CUMIN
VLADIMIR POUTINE : LA FIN D’UN RÈGNE ? Par Galia ACKERMAN
 « LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
« LA RUSE ET LA FORCE AU CŒUR DES RELATIONS INTERNATIONALES CONTEMPORAINES »
 L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
L’INTER-SOCIALITE AU COEUR DES DYNAMIQUES ACTUELLES DES RELATIONS INTERNATIONALES
LES MIRAGES SÉCURITAIRES. Par Bertrand BADIE
 LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
LE TERRITOIRE EN MAJESTÉ. Par Thierry GARCIN
UNION EUROPÉENNE : UNE SOLIDARITÉ TOURNÉE VERS UN PROJET DE PUISSANCE ? Par Joséphine STARON
LES TALIBANS DANS LA STRATÉGIE DIPLOMATIQUE DE LA CHINE. Par Yohan BRIANT
🔎 CHINE/ETATS-UNIS/TAÏWAN : LE TRIANGLE INFERNAL. Par P.A. Donnet
LA RIVALITÉ CHINE/ÉTATS-UNIS SE JOUE ÉGALEMENT DANS LE SECTEUR DE LA HIGH TECH. Par Estelle PRIN
🔎 LES « MÉTAUX RARES » N’EXISTENT PAS... Par Didier JULIENNE
🔎 L’ARCTIQUE DANS LE SYSTÈME INTERNATIONAL. Par Thierry GARCIN
LES PARAMÈTRES DE LA STRATÉGIE DE DÉFENSE DE L’IRAN. Par Tewfik HAMEL
🔎 LES NOUVELLES GUERRES SYSTEMIQUES NON MILITAIRES. Par Raphaël CHAUVANCY
L’INTERNATIONALISME MÉDICAL CUBAIN AU-DELÀ DE L’ACTION HUMANITAIRE. Par G. B. KAMGUEM
UNE EUROPE TRIPLEMENT ORPHELINE
LA DETTE CHINOISE DE DJIBOUTI. Par THIERRY PAIRAULT
CONSEIL DE SECURITE - L’AFRIQUE EST-ELLE PRÊTE POUR PLUS DE RESPONSABILITÉ ?
COMMENT LA CHINE SE PREPARE POUR FAIRE FACE AU DEUXIEME CHOC ECONOMIQUE POST-COVID. Par J.F. DUFOUR
GUERRE ECONOMIQUE. ELEMENTS DE PRISE DE CONSCIENCE D’UNE PENSEE AUTONOME. Par Christian HARBULOT
LA CRISE DU COVID-19, UN REVELATEUR DE LA NATURE PROFONDE DE L’UNION EUROPEENNE. Par Michel FAUQUIER
(1) GEOPOLITIQUE D’INTERNET et du WEB. GUERRE et PAIX dans le VILLAGE PLANETAIRE. Par Laurent GAYARD
La GEOPOLITIQUE DES POSSIBLES. Le probable sera-t-il l’après 2008 ?
« Une QUADRATURE STRATEGIQUE » au secours des souverainetés nationales
L’Europe commence à réagir à l’EXTRATERRITORIALITE du droit américain. Enfin ! Par Stephane LAUER
LA DEFENSE FRANCAISE, HERITAGE ET PERPECTIVE EUROPEENNE. Intervention du Général J. PELLISTRANDI
L’EUROPE FACE AUX DEFIS DE LA MONDIALISATION (Conférence B. Badie)
De la COMPETITION ECONOMIQUE à la GUERRE FROIDE TECHNOLOGIQUE
ACTUALITES SUR L’OR NOIR. Par Francis PERRIN
TRUMP REINVENTE LA SOUVERAINETE LIMITEE. Par Pascal Boniface
Une mondialisation d’Etats-Nations en tension
MONDIALISATION HEUREUSE, FROIDE et JEU DE MASQUES...
RESISTANCE DES ETATS, TRANSLATION DE LA PUISSANCE
Ami - Ennemi : Une dialectique franco-allemande ?
DE LA DIT A LA DIPP : LA FRAGMENTATION DE LA...
Conférence de Pierre-Emmanuel Thomann : La rivalité géopolitique franco-allemande (24 janvier 2017)
Conférence d’Henrik Uterwedde : Une monnaie, deux visions (20 janvier 2016)
Conférence de Bertrand Badie : Les fractures moyen-orientales (10 mars 2016)
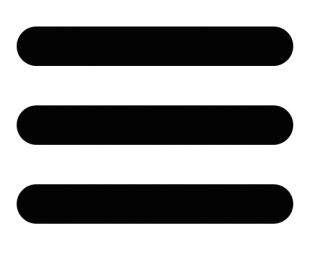

 GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...
GEOPOWEB, LIRE LE MONDE EN TROIS DIMENSIONS (Géopolitique, Géoéconomie, Philosophie politique). Mondialisation « à front renversé » : politiques d’endiguement, lois extraterritoriales, guerres hybrides, sécurité stratégique...

